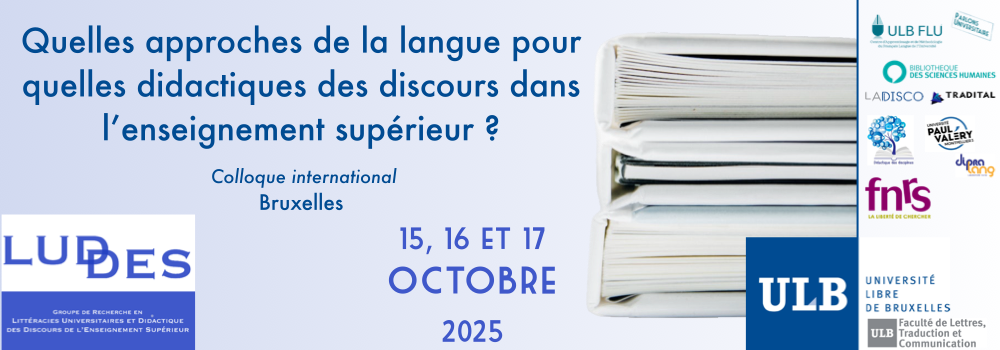
|
|
|
Appel à contributions > Pistes proposéesDans le cadre qui vient d’être exposé, plusieurs regroupements de questions peuvent servir de pistes dans lesquelles inscrire les propositions de contributions.
Piste 1 - Questions relatives aux cadres et outils théoriques pour l’analyse et la didactisation des discours dans l’enseignement supérieurDes propositions d’ordre théorique, proposant un état des recherches et avançant de nouveaux regards, peuvent explorer les questions suivantes :
Piste 2 - Questions relatives à la diversité des contextesLes travaux actuels montrent la variété des discours circulant dans divers environnements, avec des particularités liées au niveau d’études qu’ils concernent, à leurs ancrages institutionnels voire géographiques, à leurs contenus, à leurs intentions et modalités mais aussi aux communautés discursives qui les accueillent. Quelques questions peuvent dès lors être abordées dans cet ordre d’idée, par exemple :
Piste 3 - Questions relatives à l’évolution des objets, pratiques, supports et genresSi les pratiques de l’écrit ont fait l’objet des premières préoccupations didactiques dans notre champ, et si elles y occupent toujours une place importante, l’évolution de l’enseignement supérieur amène à s’interroger sur la place de nouvelles pratiques, de nouveaux objets, genres, supports et outils qui s’y implantent, notamment à l’heure de l’I.A. Les compétences langagières à développer semblent s’étendre actuellement à toutes les compétences langagières, y compris orales ou scripturo-orales, comme le montrent de récents travaux (e.a. Boyer et al., 2018 – Dufour et Parpette, 2017 – Scheepers (dir.), 2023). Par ailleurs, il devient crucial de ne pas négliger la dimension numérique des pratiques et des supports de discours, ni les divers effets que peut amener l’explosion des littéracies numériques (e.a. Daunay et Flückiger, 2018 – Flückiger, 2016, 2021, 2024 – Assis, Komesu et Pollet, 2021 – Komesu, Daunay et Flückiger, 2021 – Horning, 2024). Quelques questions peuvent être examinées dans ce cadre :
Piste 4 - Questions relatives aux étudiant.es allophones et aux situations de bi/plurilinguismeEn ce qui concerne la diversification des publics allophones dans nos universités (étudiant.es Erasmus, exilé.es, …), conjointement à une approche FLE/FLS (e.a. Omer, 2014 – Beillet et Lang, 2017 – Lang et Meyer, 2018), une tradition de recherches et de pratiques s’est constituée autour du FOS (Français sur Objectifs Spécifiques) dont une déclinaison récente, le FOU (Français sur Objectifs Universitaires), a conforté une perspective résolument pragmatique, de l’analyse des besoins à la confection d’activités ciblées (voir e.a. Mangiante et Parpette, 2012, 2022 – Bordo, Goes, Mangiante (éd.), 2016). Par ailleurs, de nombreux travaux montrent l’intérêt d’exploiter dans les dispositifs didactiques une approche plurilingue et pluriculturelle (e.a. Meunier, 2020, 2021 – Meunier, Dezutter et al., 2023 – Louis et Meunier, 2017 – Dufour, 2021). Quoi qu’il en soit, dans les cas d’étudiant.es allophones, il s’agit d’organiser leur adaptation aux discours de l’environnement institutionnel, culturel, disciplinaire et linguistique des études poursuivies. Plusieurs questions peuvent être explorées :
|

